"Le Bleu des abeilles" de Laura Alcoba
{jcomments off}
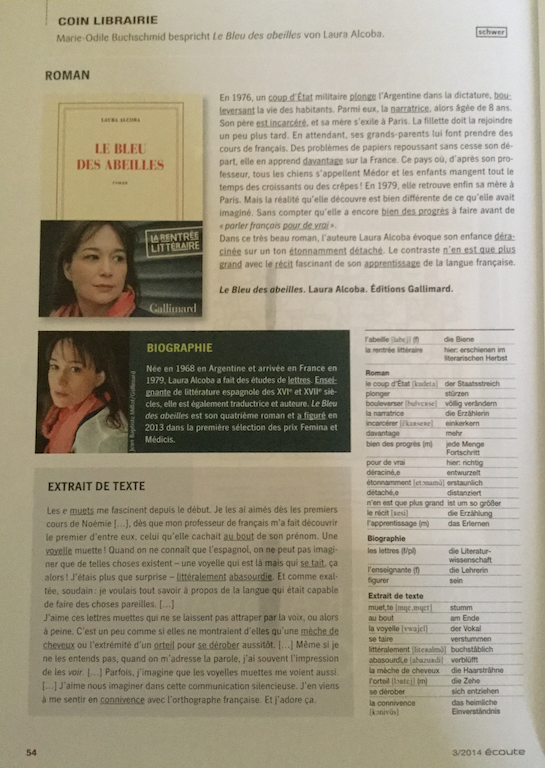
{jcomments off}
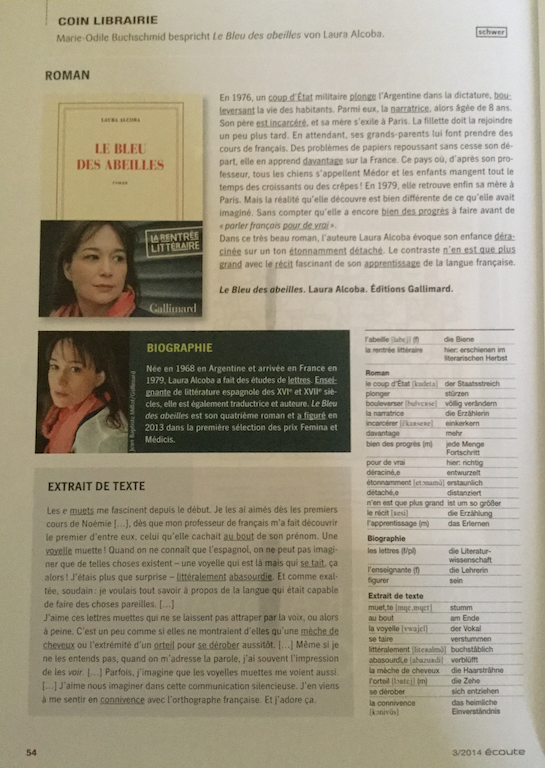
C’est ce que fait Nathalie Azoulai dans son dernier livre, Titus n’aimait pas Bérénice, paru en septembre 2015 chez POL et couronné dans la foulée par l’un des innombrables – quelque 2 000 quand même ! – prix littéraires français. Créé en 1958, le Prix Médicis, puisque c’est de lui qu’il s’agit, se proposait alors dans la mouvance du Nouveau Roman de « sauver les livres de la décadence des autres prix et récompenser la qualité d’un style », rien de moins. Apparentées aux bonnes résolutions que l’on prend en début d’année et qui ne survivent généralement pas à l’arrivée du printemps, les bonnes intentions, elles, ne résistent guère à l’épreuve des faits et autres impératifs commerciaux. Bientôt rentré dans le rang, le jury du Médicis aurait-il à l’automne dernier cherché à renouer avec ses critères originels d’attribution en distinguant une auteure qui n’est pas précisément une familière des listes de bestsellers ?
Ma découverte de Christian Bobin n’a rien de littéraire. Certes, nous avons la Bourgogne en partage, mais il est surtout le petit frère de mon professeur d’anglais de seconde et de terminale. D’où ma curiosité à l’origine qui, à la lecture de quelques-uns de ses textes, s’est muée en un réel intérêt. Chaque fois que je lis ce qu’il écrit, j’ai envie de le lire à haute voix. L’expression de « petite musique », quelque rebattue qu’elle soit, prend, appliquée au style de cet enchanteur de mots, tout son sens et ce, même si je ne le suis pas sur tous les terrains qu’il arpente : ce que l’on appelle son côté mystique me demeure étranger sans me laisser toutefois indifférente.
J’ai eu la chance de recevoir quelques lignes signées de sa main en remerciement de la traduction d’un article paru il y a un bon moment déjà dans les pages culturelles du Süddeutsche Zeitung, une page manuscrite dont je ne suis pas peu fière, mais que je n’ai cependant pas encadrée ou suspendue au mur tel un trophée. Ce serait lui rendre un hommage peu digne de ce qu’il est que de procéder ainsi.
Je viens de passer quelques jours dans la région du Creusot, pas loin du tout du village où il a sa retraite. Une parenthèse estivale après la grisaille de cet hiver qui n’en finissait pas. Parenthèse familiale et comme en marge de ma vie, de mon travail, de mes préoccupations et de la course de plus en plus folle du monde dont ne nous parvenaient plus que les images des infos télévisées vite refoulées ou le bruit des TGV fendant régulièrement l’air et le silence. Dans ces trains, des passagers se rendant toujours plus vite de A à B ou de B à A et à qui nous opposions notre immobilité lascive de vacanciers oisifs. Etendue dans un transat et au soleil de ma Bourgogne natale, je pris soudain conscience que je me trouvais au cœur de la France des terroirs, des poètes, des paroliers, des clichés véhiculés sur papier glacé par les tours opérateurs ou à travers leurs souvenirs de vacances par les touristes. Nulle trace de la crise, oubliés le chômage, les manifestations contre le mariage pour tous, l’affaire Cahuzac… La France éternelle existe, oui, je l’ai rencontrée et sais où la retrouver, où me ressourcer, dans cette Bourgogne qui « est mon berceau et la base d’envol de tous mes songes. » (Christian Bobin, interview, Lire, février 2013, page 46)
Passer devant une librairie sans en pousser la porte et en ressortir sans avoir acheté au moins un livre = impossible surtout quand comme moi, on n'a pas si souvent l'occasion de musarder dans un centre-ville français. Mon alibi était cette fois l'envie de lire le dernier livre de Christian Bobin, que je n'avais pas trouvé au salon du livre à Paris. J'en ai fait l'acquisition et, qui plus est, au Creusot, port d'attache de l'auteur. Forcément, j'en ai profité pour faire le tour des rayonnages et suis donc tombée sur “Demain, j'arrête“. Le nom de l'auteur ne me disait rien, la quatrième de couverture indique que ce livre a fait un tabac à sa sortie, mes recherches m'ont conduite à la chronique de Gérard Collard, étonnamment indulgent.
Mathilde a renoncé à une carrière dans la diplomatie pour vivre (de) sa passion, la reliure, un art que son grand-père lui a transmis. Elle s'est installée dans un petit village de Dordogne, où elle a ouvert un atelier de reliure dans une rue traversée par le gué qui donne son nom au roman. Elle a sympathisé avec les artisans dont les boutiques entourent la sienne et notamment avec un boulanger, qui depuis lui apporte chaque matin des chouquettes en échange d'un café. Son existence s'écoule tel un petit fleuve tranquille. Elle espère juste avoir bientôt plus de commandes, ce changement de vie ayant englouti toutes ses économies…
Elle se lève un matin un peu moins bien dans sa peau qu'à l'accoutumée. Elle attribue son humeur par trop nostalgique au vent et à la pluie qui se déchaînent ce jour-là. Il est très tôt encore ; elle s'apprête à se mettre au travail lorsque quelqu'un frappe et si vigoureusement qu'elle en éprouve presque de la peur. Déverrouillant la porte, elle se trouve face à un fort bel homme de carrure imposante. Ce dernier pénètre dans l'atelier, il émane de sa personne un parfum boisé si prononcé que Mathilde a l'impression que l'inconnu ne peut qu'avoir passé la nuit dans la forêt.
Il s'agit d'un client qui voudrait faire relier un magnifique ouvrage, aussi peu ordinaire qu'il l'est lui-même. Il lui dit qu'il viendra le rechercher le samedi suivant, verse 100 € d'arrhes et disparaît, sans même laisser ses coordonnées, aussi brutalement qu'il est apparu. La relieuse ne fait alors plus que penser à ce personnage si atypique, si séduisant ; elle se moque d'elle-même en constatant qu'elle se sent comme “amoureuse“. Son ami, le boulanger, remarque aussitôt son trouble. En apprenant la raison, il lui promet d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille ainsi que de lui faire part de tout ce qu'il pourra récolter comme informations.
Il tient très vite parole et ce qu'il lui raconte est de nature à mettre un terme définitif aux douces rêveries auxquelles elle avait commencé à s'adonner : l'inconnu a été renversé par un véhicule et est mort sur le coup. L'histoire ne saurait cependant s'arrêter là. Pour la bonne raison que l'annonce du décès du bel inconnu intervient à la page 52 du roman, qui en compte 244, mais aussi parce que si son propriétaire n'est plus, le livre, lui, est encore là. Lors de sa restauration, Mathilde va en effet découvrir que l'ouvrage recèle bien plus que de superbes aquarelles…
Un récit superbement mené et servi par un style aussi délicat que les gestes de la relieuse du gué !
Marie-Odile Buchschmid
Birkenweg 14
82291 Mammendorf